|
« Avoir
bonne réputation est toujours un très mauvais signe »
Philippe Sollers publie L'École
du Mystère, roman de pensée et d'inceste.
Rencontre avec un écrivain qui refuse la sagesse.
Introduction et propos recueillis par Damien Aubel
Le Montaigne du 6e arrondissement
est de retour. Comme son illustre compatriote Philippe Sollers bifurque plus
qu'il ne fonce au but. À l'instar d'un navire capricieux (un bateau ivre ?), il
a ses allures - et son allure : cette silhouette reconnaissable entre toutes du
vieux sage malicieux. On l'aura compris. Philippe Sollers, qui nous reçoit dans
sa thébaïde des éditions Gallimard, revendique toujours la même liberté. Celle
de dérouter et de se dérouter. De pratiquer la contradiction comme un exercice
spirituel permanent. Hygiène intime de l’intellect, jeu de l'esprit, jeux
d'esprit. Alors, dans cette École du Mystère, Sollers s'en donne à cœur joie. Il y a la chair (un chapelet de
scénarios fantasmatiques avec la sœur-muse, Manon) et les Mystères de la
foi : les vieux ennemis de la culture occidentale s’épousent. La « story » et la théorie se rabibochent. Sollers
l’entremetteur : son École du Mystère est une noce permanente des contraires. Fusion, mais pas confusion. Sollers
sait où il se trouve, et d’où il parle : contre. Contre les corps soumis à
la technique, contre le progressisme bien-pensant, contre l’oubli. Mais la
contradiction, pour ne pas dégénérer en rumination bilieuse, doit se faire en
groupe. Sollers convoque ses vieux camarades : Rimbaud et Baudelaire, mais
aussi Heidegger et Spinoza. Contre là encore – mais tout contre –
la pensée et la poésie.
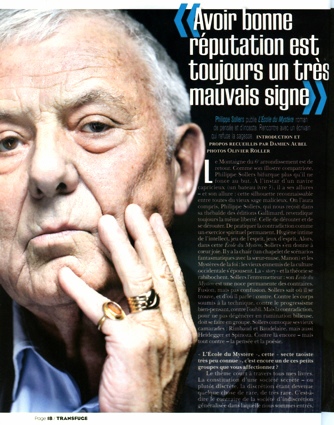
« L’École du Mystère », cette « secte
taoïste très peu connue », c’est encore un des ces petits groupes que vous
affectionnez ?
Le thème court à travers tous mes
livres. La constitution d’une société secrète - ou plutôt discrète, la discrétion étant devenue quelque chose
de rare, de très rare. C'est-à-dire le contraire de la société d'indiscrétion
généralisée dans laquelle nous sommes entrés.
En lisant L'Ecole du Mystère, on
pense à Femmes : « Le monde
appartient aux femmes. C'est-à-dire à la mort. Là-dessus tout le monde ment. »
La conclusion est très importante
: « Là-dessus tout le monde ment. »
Et ça continue. On oublie la mort, la mort dont Hegel dit que c'est « le maître
absolu ». Dans L'École du Mystère, je
cite Zhuangzi : « Qui connaît la
joie du ciel ne craint ni la colère du ciel, ni la critique des hommes, ni l'entrave
des choses, ni le reproche des morts », et j'ajoute : « ni l'aigreur des
femmes ». Nous sommes toujours dans cette histoire de guerre des sexes
millénaire, mais qui a pris un tour nouveau avec la prise en compte des
substances reproductives, n'est-ce pas... Comme je l'ai annoncé dix fois, vingt
fois, trente fois sans que personne ne semble s'en être rendu compte...
On ne vous lit donc pas, ou peu, ou mal ?
On ne lit plus rien. Qu'est-ce que
je fais ? Je fais tranquillement mon encyclopédie, y compris dans le roman,
pour dire que le plus inquiétant, c'est la perte de la possibilité de
mémorisation et de lecture. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'habite
dans ce bateau [Gallimard] qui a un siècle et dont vous entendez les fantômes
passer dans les couloirs. Il y a tout le monde : Marcel Proust, Céline, des
gens qui ne se seraient pas parlé, pour des raisons idéologiques. Mais
l'idéologie, c'est fini, maintenant vous avez la « marketologie » - c'est tout
à fait autre chose. Ça veut dire que tout le monde s'appelle de plus en plus «
marketing », à tous les étages, même ici : Marie-Françoise Marketing, Jean-François
Marketing...
La mémoire, c'est le Mémorial de Pascal, mais aussi un « muscle »...
Mémorial, oui, celui de Pascal, mais attention, le « mémorial
», le devoir de mémoire, ce n'est pas l'exercice fondamental de la mémoire, qui
doit toujours être personnelle et singulière. Si vous n'entraînez pas votre
mémoire, c'est un muscle qui a tendance à devenir flasque. Dans le « flasque »
s'engouffre la communication, et pas seulement, mais tout ce qui nous est servi
comme spectacle permanent. Voilà la situation vraie en dehors de tout ce qui se
bavarde chez les intellectuels...
Que pensez-vous de l'unanimité au lendemain de
l'attentat et de la prise d'otages ?
Vous avez remarqué que la formule
« union nationale » se présente à chaque instant dans les commentaires. Ce qui
m'évoque une expression que j'ai entendue très tôt dans ma vie - la «
Révolution nationale » du gouvernement de Vichy et du maréchal Pétain, acclamé
par des foules considérables avant qu'elles n'acclament, le surlendemain, le général
de Gaulle. Le coup de l’union nationale, c'est aussi pourquoi on vous rappelle
1918. La question politique m'intéresse au même titre que L’École du Mystère qui ne fait pas apparemment de politique alors
que, de mon point de vue, c'est un livre tout à fait révolutionnaire et
politique, bien sûr.
Dans votre livre, il est question de Révolution
française...
Une révolution qui n'a pas été
pensée. Qui l'a pensée philosophiquement ? Les Français sont incapables de
penser. Il a fallu un penseur qui n'était pas français : Hegel. Marx, qui était
quelqu'un de très brillant, s'est rendu compte qu'il avait besoin de Hegel. De
la philosophie allemande. Quant au socialisme français, il y avait une masse de
gens qui étaient anarchistes, dont Proudhon, que Marx passe son temps à
critiquer. D'ailleurs, la fibre anarchiste en France est très profonde,
beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça se voit avec Charlie Hebdo. Au fond, c'est la fibre républicaine essentielle qui
est là, profondément.
En parlant de philosophes, vous évoquez Heidegger...
Ce qui se passe avec Heidegger est
absolument accablant. Ça tourne à la farce... Le camarade Moix est charmant par
ailleurs, mais mettre Heidegger avec Péguy comme il le fait [dans La Règle du jeu]... franchement…
La philosophie a-t-elle le monopole de la pensée ?
Écrire au sens où je l'entends,
c'est penser, pas seulement raconter. On peut faire de très bons romans,
naturalistes, sociétalistes, pourquoi pas... Mais moi, ça m'ennuie. Je trouve
que la littérature pense parfois même plus que la philosophie. Mais parfois, un
philosophe fait sensation : ce qu'il a dit, personne ne l'a dit avant lui.
Hegel. Nietzsche. Heidegger.
Aux antipodes d'Hegel, de Nietzsche ou d'Heidegger, il
y a le piètre écrivain Virginie Despentes. Vous avez lu son dernier livre ?
Elle a dit quelque part que j'étais
courageux. Elle est sympathique...
Soumission de Houellebecq a fait des vagues - surtout
au vu du contexte actuel...
Je me situe par rapport à
Houellebecq aux antipodes - il fait noir et gris, moi bleu et jaune... Mais ce
qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont il se sert de Huysmans dans son
roman pour se demander s'il ne pourrait pas y avoir un retour au catholicisme.
Lequel ? Celui, tout à fait décomposé, du catholicisme français. Ça l'amène à
faire une visite extrêmement drolatique au monastère de Ligugé, puis à
Rocamadour. Ça, c'est français. Ensuite, on récite du Péguy, Péguy ça tombe bien,
c'est le premier martyr de la boucherie de la Première Guerre mondiale. Bref,
vous êtes déporté, si je peux dire, vers un passé qui ne passe pas, et ça c'est
un problème français. De même, si vous allumez une allumette en même temps sur
la fibre anarchiste de Charlie Hebdo - quatorze morts - et sur l'Hypercacher, si vous faites ce court-circuit,
l'émotion est immense.
Toujours sur l'actualité, Alain Finkielkraut
s'exprimait récemment dans Le Figaro...
Ah, Le Figaro... Mais il y est tout le temps, Alain Finkielkraut.
D'ailleurs, il est tout le temps partout... Mais vous voyez, à ce stade de la
conversation, en abordant ces sujets, on s'éloigne de la littérature...
Alors
revenons-y. L'écrivain est-il plus important que l'intellectuel ?
Les intellectuels parlent
beaucoup, et en général pour dire le bien, ce qui a parfois son importance
relative. Je vous citerai simplement un titre, qui me convient parfaitement, La Littérature et le Mal de Bataille.
Dès qu'on parle du mal, c'est comme pour la mort, on tombe assez vite sur une
surdité tout à lait révélatrice. Il y a dans la littérature quelque chose qui
touche à l'intime de l'expérience vécue, qui ne peut pas être relayée par un
discours ensembliste, communautaire ou autre.
Le premier volume du journal intime de Philippe Muray, Ultima necat, est sorti récemment...
C'était un grand ami, je l'ai
publié - son Céline, son XIXe siècle à travers les âges -, on a souvent travaillé côte à côte. Mais le Muray qui m'intéressera plus,
c'est celui de la fin, celui qui dira beaucoup de mal de moi…
Il n'est déjà pas toujours très tendre...
Il paraît que
je suis un renard, c'est sa veuve qui le dit... Il a mis très longtemps à
m'attaquer publiquement. Il y a maintenant ses trois veuves, Élisabeth Lévy, Aude
Lancelin et son ex-femme. Il est adulé aujourd'hui, récupéré grâce à Luchini.
Il a perdu sa mauvaise réputation...
Comment expliquez-vous sa dureté ?
Revenez à la littérature et vous
comprendrez. Muray avait un talent extraordinaire, qui s'est révélé tard.
Depuis, il a été marketéologisé, idéologisé... Il a publié des romans, mal
édités, mal pensés, mais peu importe. Ça a été pour lui un choc très dur. Il y
avait aussi sa poésie. Comme Houellebecq, il a fait de la poésie aussi... pas
terrible. Moi, je continuais tranquillement mon parcours - avec une très
mauvaise réputation. Donc je suis très content, et que j’alimente… Avoir bonne
réputation est toujours un très marnais signe. Regardez Debord, qui a écrit Cette mauvaise
réputation, le voilà « Trésor national ». Je ne suis pas un « Trésor
national ». Et s'il le faut, j'ajouterai trois louches d'acide nitrique dans le
spectacle...
Vous parliez d'amitié - on pense à Barthes aussi, dont
vient de sortir une biographie par Tiphaine Samoyault...
Dans le livre très minutieux, très
scrupuleux de Tiphaine Samoyault, il y a un chapitre sur Barthes et Gide et un
chapitre sur Barthes et moi. C’était un très grand ami, et sa mort m'a beaucoup
chagriné. Dans L'Express, il v a eu
cet article pour dire que Barthes
avait besoin de mon « abattage médiatique ». Vous voyez comment on
falsifie l'Histoire, mais aussi comment on la réécrit. En 1965, quand Barthes
s’enthousiasme pour mon Drame, Philippe Sollers est un citoyen absolument
inconnu du médiatique… Il y avait entre nous un accord littéraire et politique
- Barthes était un des rares antifascistes spontanés que j’ai connus. Je n'ai
pas dit « révolutionnaire », mais « antifasciste ». Quant à Gide, étant
donné la néantisation permanente, il devient un personnage considérable : la
création de la NRF, tout ça, ça devient une aventure qui fait qu'un siècle
après, vous êtes à L'Infini chez
Gallimard.
Vous envisagez « un tout autre roman, en plein XXIe siècle et qui fait exploser l'espace, la vie, la mort, le temps », tout autre
que ce qui se pratique aujourd'hui.
C'est tout à fait diffèrent de ce
qui se fait aujourd'hui, du retour massif au XIXe siècle, au
réalisme sociétaliste. Nous sommes là dans ce qui est prôné, les résidus du
réalisme et du naturalisme. Comme si le XXe siècle n'avait pas
existé.
Vous parliez de « mauvaise réputation ». Un
écrivain qui a bonne réputation, lui, c'est J. M. G. Le Clézio, à qui les
attentats ont inspiré une « lettre à sa fille » dans Le Monde.
Oh, notre prix Nobel... Écoutez, c'est
un western... Je suis le méchant, moi. À la fin du film, ma main se crispe
toujours sur une liasse de dollars que je n'atteindrai jamais, parce que j'ai
été descendu. Et Le Clézio, lui, s'éloigne dans le soleil couchant, sur une
musique de film admirable. Le plus drôle, c'est qu'ils auraient pu trouver un
remplaçant depuis le temps que ça dure, mais non, je suis réengagé par la prod. Alors il y a Modiano [il singe la parole un peu
bégayante de Modiano], le révérend Quignard qui m'enterre en latin, le saloon
qui a été fondé par Marguerite Duras où on trouve les nouveaux arrivants qui
font un tabac : Christine Angot, Michel Houellebecq, Virginie Despentes. Et
puis des conférenciers intellectuels viennent de temps en temps faire des
conférences dans cette petite bourgade du Texas, où je suis mort, hélas ! Y a
tout le monde, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut : les conférences sont très
suivies. Et de temps en temps, j'y suis très sensible, une fleur est déposée
sur ma tombe. Mais c'est une fine main, une main féminine qui est venue
l'apporter.
Transfuge, février 2015
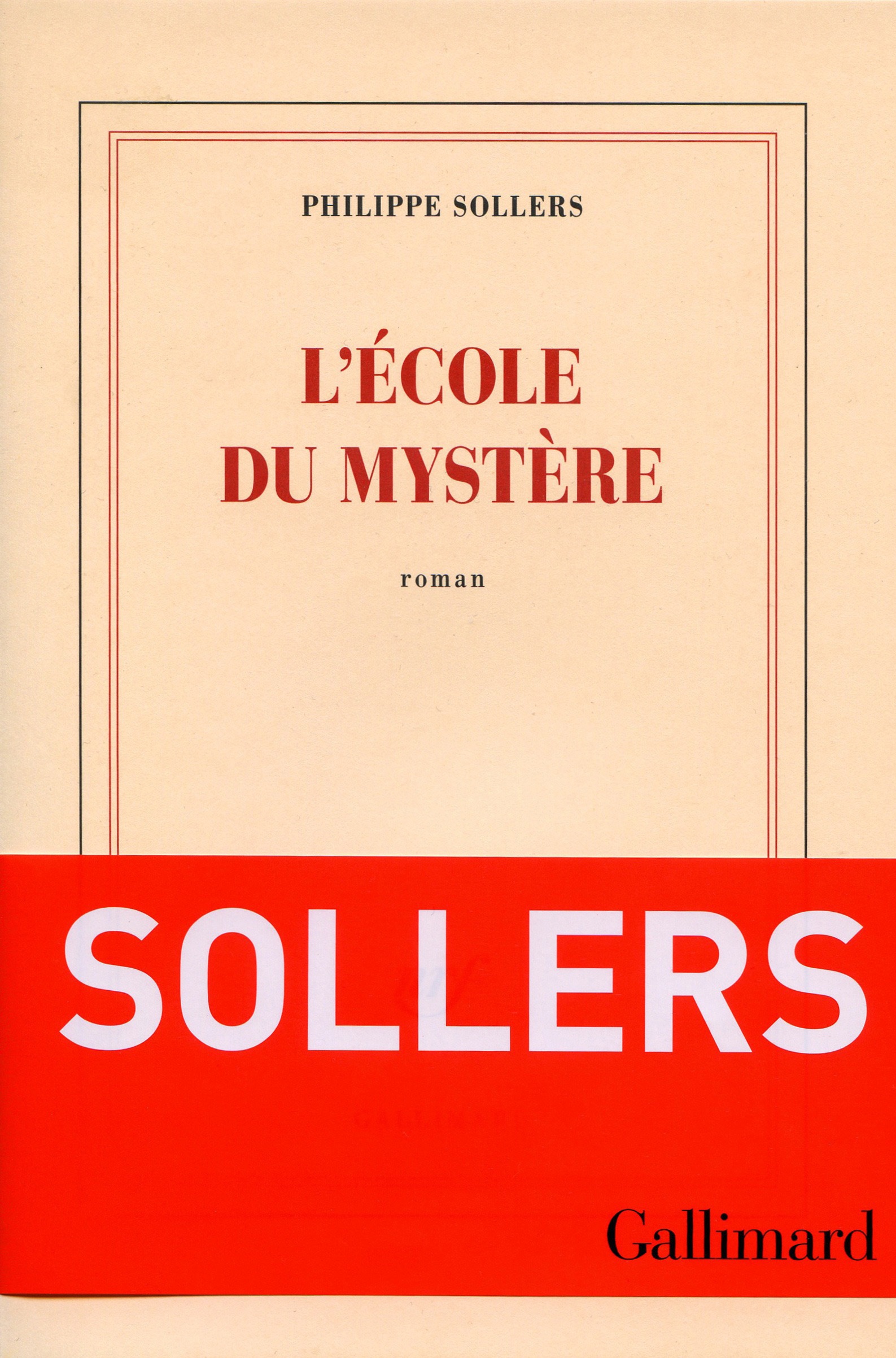
L'École du Mystère
|